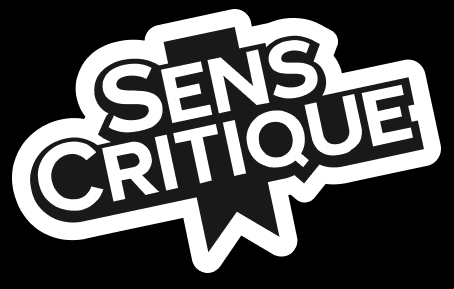Dans l’esprit des cinéphiles, John Milius reste principalement connu comme celui qui a jamais su porter avec réussite à l’écran le personnage de Conan créé par Robert E. Howard. Au semblant peu prolifique, il est de ces cinéastes qui pourtant, tel un George A. Romero, ont essayé de porter bon nombre de projets à l’écran durant leur carrière sans perdre pour autant leur intégrité artistique. Bref, John Milius, c’est pas le genre Michael Bay, à faire cinq Transformers pourris l’un après l’autre juste parce que ça lui rapporte énormément de fric même si c’est de la daube.
Au début des années 2000, Milius vient de se lancer dans la fiction télévisuelle avec succès avec un biopic sur Theodore Roosevelt, un de ses héros. La série est un succès mais n’empêche pas Milius d’être ruiné par un comptable véreux. Essayant de porter à l’écran son scénario King Conan, qu’il a écrit et peaufiné sur plus années, et qu’il considère comme la seule vraie suite de son Conan le barbare (Conan le destructeur ?... Qu’est-ce que c’est ?), Milius compte bien se refaire, artistiquement et financièrement. D’autant plus que Schwarzenegger semble vouloir rempiler dans le rôle du barbare vieillissant, la star de Terminator s’étant dit emballé par son scénario. Sauf qu’en 2004, les priorités de Schwarzenegger ne sont plus les mêmes, le cinéma l’intéresse moins que la politique et il vise désormais le siège de gouverneur de Californie plutôt que le trône du roi Conan. Sans la star, le projet tombe à l’eau et King Conan devient un de ces films mythiques qui n’auront jamais vu le jour. Milius est dégoûté.
Contractuellement lié à lui, le studio Warner lui propose alors de porter sur petit écran un autre de ses vieux projets dédié à l’ascension de Jules César et à la naissance de l’empire romain. Milius accepte et, protégé par la politique d’HBO (des héros moralement douteux, un peu de sexe, beaucoup de sang) décide d’injecter dans cette production essentiellement britannique un peu de la dimension politique et guerrière qu’il envisageait pour King Conan. Pour autant, c’est l’autre créateur du show, le jeune scénariste Bruno Heller (futur créateur des séries The Mentalist et Gotham) qui reste le showrunner officiel. Envisagé au départ sur cinq saisons, la série Rome n’en fera finalement que deux, une décision prise par la Warner en toute fin de première saison, au vu du budget pharaonique que la production a englouti sur ses décors, costumes, accessoires et figurants.
Qu’à cela ne tienne, pour la seconde saison, Heller et Milius, bien aidés par des réalisateurs de talents (Allen Coulter et Tim Van Patten, transfuges des Soprano, Carl Franklin et même Alan Taylor, futur réalisateur d’épisodes clés de Game of Thrones), vont s’employer à condenser plusieurs grands événements historiques (la guerre des Césariens, le triumvirat, la romance entre Marc Antoine et Cleopâtre) et dégraisser la grande histoire (la guerre contre les Parthes n’est ici pas évoquée) pour narrer le tout en une dizaine d’épisodes. Si la première saison suit l’ascension de Jules César (Ciarán Hinds, impérial) de sa victoire à Alésia à son assassinat au sénat, la seconde suit les conflits engendrés par sa disparition, des dernières années de la république aristocratique romaine jusqu’à l’avènement de l’empire sous Octave, futur Auguste. Tout ceci narré en parallèle aux tribulations de deux soldats romains et principaux protagonistes de la série : le centurion Lucius Vorenus (Kevin McKidd, excellent) et le légionnaire Lucius Pullo (le regretté Ray Stevenson dans son rôle le plus célèbre). L’idée maîtresse de la série est que la destinée des deux hommes (tous deux inspirés de deux valeureux centurions romains évoqués par Jules César dans son ouvrage Commentaires sur la guerre des Gaules), va souvent interagir avec la grande histoire, voire la provoquer (Pompée aurait peut être été gracié par César si Vorenus ne l’avait pas laissé s’échapper, Pullo est quant à lui le père de Césarion, l’enfant qui scellera l’union de César et Cleopâtre, Pullo est aussi l’assassin de Cicéron et Vorenus aurait pu empêcher l’assassinat de César s’il avait été présent au sénat).
Les deux frères d’armes sont ainsi présentés comme les deux principaux référents du spectateur. Ce sont eux qui assistent au plus près à l’écriture de l’histoire. Ce sont eux qui, indirectement, y contribuent aussi. Véritables anti-héros en cela qu’ils sont aussi ambivalents l’un que l’autre (Vorenus est autoritaire, colérique, rigide et torturé, mais reste fidèle à son épouse et à un idéal de république, Pullo est plus épicurien, insouciant et pragmatique) et reflètent à eux-seuls le manque d’empathie qui régnait à cette époque, les deux personnages sont liés l’un et l’autre par un sens de la loyauté sans failles qui les fera devenir les meilleurs amis du monde, et ceci même s’ils ne seront pas toujours d’accord ou dans le même camp politique. Le courage, l’amitié, la loyauté et l’honneur sont ici ce qui les motivent le plus, à cela s’ajoutant l’amour qu’ils vouent chacun à leur épouse respective. Mais cet amour-là nous est justement dépeint comme il devait l’être à une époque où les femmes n’avaient aucun droit, si ce n’est de bénéficier de la protection, du rang ou de la fortune de leur époux ou du titre patriarcal de leur famille (Atia est une Julii, Servilia une Junii, héritière de la lignée de Romulus). Ainsi, Vorenus est-il décrit comme un homme amoureux de Niobé (Indira Varma, revue plus tard dans Game of Thrones) mais toujours à la limite de la violence conjugale, quand Pullo, amoureux fou d’Ereine, étrangle son amante Gaïa quand celle-ci, au bord de la mort après lui avoir sauvé la vie, lui avoue avoir empoisonné sa défunte épouse.
Ce rapport de force et de violence entre hommes et femmes nous est montré à plusieurs occasions dans la série, qu’il s’agisse de César giflant Servilia après qu’elle l’ait elle-même giflé, Marc Antoine (James Purefoy, parfait de cynisme et de cruauté) faisant de même avec Atia, le sort des filles de Vorenus lorsqu’elles sont vendues en esclavage, celui des femmes se prostituant dans les bordels romains ou encore cette séquence d’amour ionné voyant Marc Antoine et Cléopâtre se battre et faire l’amour dans leur palais d’Alexandrie. Les créateurs de la série ne cèdent ainsi à aucune bien-pensance révisionniste en souhaitant nous montrer la réalité historique dans ce qu’elle avait de plus injuste et cruelle, chose qui serait difficilement présentable dans une série actuelle, notre époque étant plus encline à ne pas choquer les consciences.
Au final, au coeur de cet immense nid de vipères qu’est la série de Milius et Heller, seule une poignée de personnages peuvent nous paraitre moralement positifs (Octavia et Agrippa par exemple). Les autres sont constamment tournés vers leur orgueil ou en quête de pouvoir. En cela, le personnage d’Atia (la remarquable Polly Walker), véritable figure de femme de pouvoir, manipulatrice et ambitieuse, préfigure bon nombre de personnages féminins de la télévision (Cersei dans GoT, Lucretia dans Spartacus). Sa destinée, particulièrement ironique, l’humanise en cela que, parvenue à ce à quoi elle a toujours aspiré, elle semble incapable de s’en réjouir, prisonnière du souvenir de son amour perdu.
Outre les personnages avides de pouvoir et la violence sexiste, la série nous rappelle que la valeur d’une vie humaine à l’époque de la Rome antique était bien faible et ne tenait qu’au rang, à la fortune et à l’entourage. Dans leur aisance à donner la mort tout au long de la série, Lucius Vorenus et surtout Titus Pullo reflètent parfaitement la mentalité de leur époque, et ce d’autant plus que les deux hommes sont deux soldats ayant survécu aux champs de batailles de Gaule. La scène de l’exécution de Cicéron en fin de saison 2 est en cela très explicite dans ce qu’elle montre de l’opposition entre la nonchalance de Pullo, venu tuer un sénateur tout en cueillant des pêches dans le jardin de celui-ci, et l’appréhension vécu par Cicéron (David Bamber) face à l’imminence de son propre trépas (son regard jeté vers le ciel avant d’accepter son sort). La mort dans la série Rome est souvent d’une grande violence mais n’est jamais présentée comme facile ou complaisante, en témoignent celle de Brutus (Tobias Menzies), pleine d’honneur, défiant à lui seul les troupes ennemies (et reproduisant celle de Jules César qu’il a trahi), ou encore celle de Marc Antoine, lui-même pourtant toujours prompt à tuer, celle de Cléopâtre, choisissant méticuleusement son poison, ou encore, bien sûr, celle de Jules César, dans cette scène d’anthologie voyant son assassinat, filmé de façon à traduire la confusion de l’instant via le point de vue de César. Une séquence qui conclue d’ailleurs fort habilement les enjeux de la première saison alors que nous est montré en parallèle une autre mort, ironiquement un suicide conjugal qui anticipe sur la colère d’un mari trompé.
Ce traitement de la violence, de l’ambivalence des personnages, de leur sort souvent funeste, et des intrigues de cour, aura permis à la série d’acquérir une aura singulière dans l’histoire de la télévision, ouvrant la voie à une série comme Game of Thrones qui en puisera d’ailleurs les composantes (acteurs compris : Ciarán Hinds, Indira Varma, Tobias Menzies...) en les appliquant à un univers de dark fantasy semi-réaliste. En ce sens, l’influence de Rome reste énorme, et ce bien que la série semble aujourd’hui quelque peu oubliée. Des séries comme Spartacus, Roman Empire, Romulus, Those about to die ou des téléfilms comme Jules César (avec Jeremy Sisto) ou Ben-Hur lui doivent énormément, sans pour autant se hisser à son niveau de qualité.
Il n’est donc pas exagéré d’affirmer que Rome reste une des meilleures séries produites depuis la révolution de la fiction télévisuelle induite par Les Soprano en 1999. La meilleure qu’il soit, consacrée à cette époque antique ionnante, riche en conquêtes, en trahisons... et en monstres sacrés.