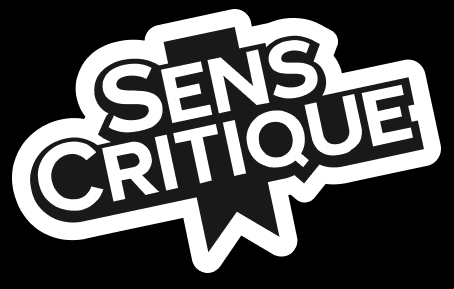Le logo HBO s’ouvre soudainement sur un fond de neige hertzienne. Puis le générique commence sur une rythmique de rythm’n blues. La main posée sur le volant, un cigare aux lèvres, Tony Soprano revient de la Grosse Pomme, e le péage et roule tout droit vers le New Jersey sur l’air mythique de Woke up this morning. Générique culte, chanson culte. Tellement culte qu’ils organisent encore des trajets touristiques en bus de New York au New Jersey pour les fans voulant se faire réellement le trajet du générique.
Mais revenons à la série : Les Soprano.
Avant 1999, les séries télévisées avaient la facture habituelle de la fiction petit format, sans réelle recherche formelle ou ambition narrative. Les cadrages y étaient dépouillés de toute ambition cinématographique, les plans larges étaient exceptionnels, les décors en arrière-plans minimalistes, la durée des épisodes ne déaient pas les 45 minutes habituelles. Seules quelques séries fantastiques comme Aux frontières du réel (X-files pour les puristes) et Buffy contre les vampires tendaient déjà vers une qualité supérieure, tout en restant limitées aux contraintes télévisuelles.
Puis en 1999, HBO lance Les Soprano. Episodes de plus d’une heure, scénarios ionnants, photographie travaillée, réalisations dignes du grand écran, interprétation high level, la série créé par David Chase devient rapidement une référence culturelle aux States et s’exporte timidement en (à l’époque, 2 en diffusait les épisodes le jeudi... à 1h du matin).
Mais il y eu clairement un avant et un après Les Soprano. À partir de là, les séries télévisées prendront une nouvelle facture à l’écran et deviendront même extrèmement compétitives par rapport au cinéma d’Hollywood, jusqu’à réduire celui-ci à un alignement de franchises aussi répétitives qu’inoffensives. Dès Les Soprano, les scénarios de nombre de séries seront plus ambitieux, les personnages plus développés, la réalisation digne du grand écran, des comédiens de grand talent accepteront d’y figurer.
C’est comme ça, sans Les Soprano, pas de Breaking Bad, de Boardwalk Empire, de Mr. Robot ou même de Rome. Et le regretté James Gandolfini, inoubliable Tony Soprano, n’aurait probablement pas eu la reconnaissance qu’il méritait.
Mais ça parle de quoi au juste Les Soprano ? De chanteurs d’opéra ?
Non.
Les Soprano, ça parle de famille.
De la difficulté d’un quadra mal-embouché et bedonnant d’origine italo-américaine à concilier son rôle de père de famille et de chef de la pègre. Capo de la mafia du New Jersey, Tony Soprano est un sociopathe un brin colérique, volage et pragmatique, déguisé en respectable entrepreneur de ramassage des ordures. Alors qu’il est le bras droit du parrain Jackie April, il doit faire face à l’enlisement de son couple, à la crise d’adolescence de sa fille et de son fils et aux remontrances d’une mère acâriatre et culpabilisatrice. Se prenant d’affection pour un couple de canards venant se réfugier dans son jardin, il est pris d’un malaise et s’évanouit subitement le jour où ceux-ci s’envolent sous ses yeux. Les examens médicaux ne détectant aucune pathologie, il semble qu’il ait simplement hyperventilé en faisant une crise d’angoisse. Il est alors orienté vers une psychiatre, le docteur Jennifer Melfi, auprès de qui il rechigne à se confier. Qu’en déduirait son entourage, familial comme criminel, s’ils apprenaient qu’il consultait une psy ? Ses adversaires, tels son oncle, le terrible Corrado "Junior" Soprano, s’en serviraient-ils contre lui ? Et les fédéraux pourraient-ils l’espionner à ses dépends ? Enfin, cette psychanalyste est-elle digne de confiance ? Peut-elle vraiment l’aider en acceptant d’écouter ses confidences ?
L’idée du mafieux consultant un psy fait inévitablement penser à la comédie Mafia blues d’Harold Ramis. À ceci près que celle-ci fut produite un an après la première diffusion américaine de la série de David Chase. Le lien entre les deux oeuvres n’en est pas moins intéressant, d’un côté nous avons De Niro, interprète modèle du mafieux à l’écran, cabotinant jusqu’à parodier ses personnages scorsesiens et depalmiens, de l’autre nous avons James Gandolfini, à l’époque un second couteau du cinéma, habitué lui aussi aux rôles de mafieux (True Romance, La Jurée, Get Shorty), de ripoux (Dans l’ombre de Manhattan) et de raclures (8mm), et qui réinvente ici l’archétype du mafieux moderne en lui conférant une dimension humaine inédite à l’écran. Dans son ambition de raconter les turpitudes d’un family man et caïd de la pègre à une époque où la grande criminalité changeait (exit les Gotti m’as-tu-vu) et où la mafia classique tendait à disparaître (voir à ce titre le Ghost Dog de Jim Jarmusch, contemporain des Soprano), David Chase n’emboitait pas seulement le pas à un Martin Scorsese, il tendait un miroir à une époque et un pays en pleine mutation, où les gangsters n’étaient plus les bandits classieux du cinéma, où l’American Way of life se résumait à un énorme mensonge, où la cellule familiale implosait et où la réussite dépendait d’une certaine propension à l’immoralité. Les codes du film de gangsters se retrouvent encore dans Les Soprano mais désacralisés, banalisés, abatardis et adaptés aux préoccupations d’une modernité écrasante, dans laquelle les criminels de la vieille école peinent à évoluer et à s’adapter. Tony Soprano lui-même nous est décrit comme un anti-héros entretenant la nostalgie d’un temps où les mafieux à chapeaux faisaient trembler l’Amérique. L’ironie étant que Scorsese lui-même, grand nostalgique de cette Amérique-là, osera snober la série en déclarant ne pas en être fan, alors que l’influence d’un film comme Les Affranchis semble ici évidente, tout comme la trilogie corléonienne de Coppola (Les Soprano réemploira d’ailleurs plusieurs acteurs de ces films, comme Dominic Chianese ou Michael Imperioli).
D’autant plus que les mafieux dans Les Soprano ont plus à voir avec ceux, semi-parodiques, de Ghost Dog, que des criminels classieux de Scorsese. Au placard, les costards cravattes des Affranchis et de Casino, les gangsters de la pègre de Jersey se baladent le plus souvent en jogging et en survet. Ils n’ont rien des mafieux sacralisés pendant 50 ans par le cinéma. Ils sont les témoins d’une époque qui s’achève et dans laquelle ils luttent absurdement pour garder leur place. En rusant contre le FBI, en collaborant avec la pègre napolitaine et en éliminant systématiquement la moindre balance violant l’omerta. Alors que sa propre famille lui échappe, Tony Soprano met un poing d’honneur à maintenir son organisation à flot. Le nombre de ses victimes, amis comme parents, alliés comme ennemis, est proportionnel aux souvenirs qui souvent, en rêve, reviennent le hanter. Comme l’oeil de la conscience braquée sur lui (La Conscience, poème de Victor Hugo), la morale vacillante d’un personnage à jamais divisé entre deux mondes. Bon nombre d’autres protagonistes répondront à ses turpitudes, certains le surant en méchanceté (Ritchie April, Ralphie Cifaretto), d’autres lui opposant un sens moral auquel il ne comprendra rien.
Les épisodes et les scènes cultes s’enchainent tout au long de ces six saisons, du "nettoyage" de Ritchie April à ce règlement de comptes inattendu en fin de saison 4, en ant par la tentative d’assassinat de Tony en pleine rue et cet épisode où, incapable de comprendre l’intégrité d’un policier, Tony tente sans succès de le corrompre. On retiendra aussi cet épisode de la seconde saison où, en visite à Naples, Tony découvre le fonctionnement de la mafia italienne et hérite d’un homme d’un main, Furio, qui aura tôt fait de faire ses preuves, et qui lui-même se verra déchiré plus tard entre sentiment et loyauté. Parmi la flopée de grands moments proposés par cette série, il y a aussi cet épisode éprouvant, dans lequel le docteur Melfi est agressée dans un parking. Apprenant par la suite que son violeur ne sera pas inquiété par la justice, elle ne voit alors qu’une solution pour obtenir justice : tout dire à son patient Tony Soprano. Mais sachant qu’elle signera là l’arrêt de mort de son agresseur, elle préfèrera s’abstenir. L’image du rottweiler qu’elle peut lâcher à tout moment sur son agresseur, ce sentiment de pouvoir de vie ou de mort, suffira un temps à la rassurer.
Au casting, James Gandolfini trouvait ici le rôle de sa vie, coiffant au poteau des pointures comme Vincent d’Onofrio ou Ray Liotta, eux aussi en lices pour le rôle. Longtemps abonné à des rôles ingrats sur grand écran, Ganfolfini exprimera ici tout son talent dans un rôle des plus ambivalents, celui d’un sociopathe en puissance mais dont la part humaine (son regard fatigué, son air blasé) nous fera ressentir plus que de la sympathie, de l’attachement. À ses côtés, Eddie Falco excelle dans son rôle d’épouse bafouée, desperate housewive avant l’heure, incapable de se dépétrer de sa situation de femme entretenue. Lorraine Bracco, qui jouait l’épouse de Ray Liotta dans Les Affranchis, incarne ici avec beaucoup de subtilité le rôle de la psy, le docteur Melfi. Du côté des mafieux, nous relèveront surtout les prestations de Michael Imperioli dans le rôle de Christopher Moltisanti, le neveu "boulet" et homme à tout faire de Tony, de Steven Van Zandt (connu pour être le guitariste du E Street Band de Bruce Springsteen) dans le rôle de Silvio Dante le consigliere, de Tony Sirico (authentique ancien mafieux) dans le rôle de l’hilarant psychopathe Paulie Gualtieri, de Vincent Pastore dans le rôle de l’ambivalent Salvatore, de Michael Rispoli (vu en homme de main dans Kick-Ass) dans le rôle du parrain par interim Jackie April, et de Dominic Chianese (vu en homme de main d’Hyman Roth dans Le Parrain 2) dans le rôle de l’oncle Corrado Junior, vieillard pétri d’amertume, frustré de s’être vu ravir le rôle de "chef" de famille par son neveu. À ceux-ci s’ajoutent l’immense Nancy Marchand (dans son dernier rôle) en mère acariatre, aussi geignarde que venimeuse, les talentueuses Drea de Matteo et Aida Turturro, le génial Joe Pantoliano dans le rôle détestable à souhait de Ralphie Cifaretto, ou encore Steve Buscemi en cousin Tony Blundetto. S’ajoutent encore des guests stars telles que Annabella Sciorra, Robert Patrick, John Heard, Robert Loggia, Lola Glaudini, Charles S.Dutton ou encore David Strathairn.
Que dire de plus ? Géniale, addictive, émouvante, étonnante, hilarante, cruelle, mythique, Les Soprano est une tragi-comédie qui dée son époque de production pour s’adresser encore à la notre. Elle reste toujours, 26 ans après sa création, LA série à voir et (re)voir. Bon nombre d’autres séries de gangsters s’employèrent par la suite à marcher sur ses traces et à en retrouver le génie (Boardwalk Empire, Lilyhammer, The Shield, Deadwood, Sons of Anarchy, Narcos, Peaky Blinders, Tulsa King) sans tout à fait y parvenir. À mon sens, seules des séries telles que Breaking Bad, Better Call Saul, Mr. Robot et Rome lui tiennent la dragée haute. Mais ces dernières auraient-elles pu seulement exister sans Les Soprano ?
Pas sûr.