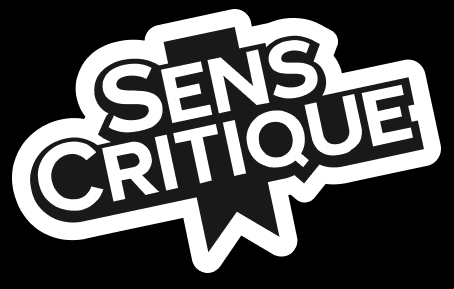J’ai toujours préféré la folie des ions à la sagesse de l’indifférence.
La relative obscurité dans laquelle est tombé Anatole apparaît comme une grande injustice quand on prend la peine de lire une de ses œuvres.
Certes, il a commis l'infâme forfait d'appartenir à cette pitoyable et inutile assemblée, peuplée principalement de vieillards cacochymes et séniles dont les rares fonctions vitales, encore en exercice, sont plus occupées à digérer de copieux et luxueux repas aux frais de la princesse que de continuer à nous offrir de la bonne littérature — en partant du principe hasardeux que la plupart de ces croulants immortels, oubliables et oubliés, aient donné la moindre ligne digne d'intérêt auparavant — et à enrichir la langue de Molière. Mais bon, des géants comme Jean Racine, Jean de La Fontaine, Pierre Corneille, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, François-René de Chateaubriand, François Mauriac, Maurice Genevoix, Marcel Pagnol ou encore Marguerite Yourcenar sont, eux aussi, coupables de ce crime.
Non, ce n'est pas parce qu'il est allé souvent somnoler quai Conti, qu'il a porté comme patronyme -- horreur suprême — un nom propre si conspué de nos jours, qu'il a été honoré comme ce n'est pas permis de son vivant — y compris par un prix Nobel de littérature — qu'il mérite d'être ignoré. Déjà, alors que ça faisait dix-sept ans qu'il portait son costume de carnaval, il a réussi à écrire un roman fort et magnifique : Les dieux ont soif. Ce livre révèle une personnalité attachante, ayant un regard d'une bonté extrême, mais d'une lucidité impossible à prendre en défaut, sur ses congénères humains. De plus, son style d'écriture doit être autant d'être complimenté pour sa richesse que pour sa clarté. Le presque septuagénaire avait encore une acuité d'esprit et un talent littéraire justifiant les plus grands éloges.
Mais, il n'avait pas attendu que le temps blanchisse ses cheveux et sa barbe pour être remarquable. Les qualités irables de sa personnalité, alors qu'il était encore trentenaire, étaient déjà présentes dans Le Crime de Sylvestre Bonnard. J'ai même ressenti, au cours de ma lecture, du fait de l'ironie tranquille du futur académicien, de sa célébration de la "folie douce", de son amour des êtres vivants (deux personnages félins ont droit à autant d'attention que les autres !), quelques échos de ce qui fera la puissance d'un Romain Gary. OK, Anatole n'est peut-être pas aussi expansif que l'auteur de La Vie devant soi en ce qui concerne cette caractéristique humaniste, mais ça contribue largement à me le rendre sympathique.
Nous sommes d’éternels enfants et nous courons sans cesse après des jouets nouveaux.
On sent qu'il a mis beaucoup de lui-même dans le portrait qu'il fait de son protagoniste : Sylvestre Bonnard, vieux garçon, philologue, membre de l'Institut (il y a des signes annonciateurs !), érudit, bibliophile, ant la majorité de son existence dans le calme de sa splendide bibliothèque de son appartement parisien.
L'ensemble est constitué de deux récits — qui aurait pu faire l'objet de deux nouvelles séparées, vu que les histoires sont complètement indépendantes l'une de l'autre — racontés sous la forme d'un journal intime par notre intellectuel vite attachant.
Le premier de ses récits est somme toute assez prévisible pour ce qui est du déroulé et des révélations — au age, il n'est pas interdit de penser qu'un certain Hergé s'est peut-être inspiré d'un des rebondissements pour un des albums de Tintin, dont le titre contient un adjectif de couleur. Mais le ton vif, enlevé, généreux en humour fin et en autodérision savoureuse, emporte l'adhésion. On suit notre personnage institutionnel qui veut absolument mettre la main sur un ouvrage rare, quitte à sortir avec fracas du calme de son quotidien pour aller au fin fond de la Sicile.
Le second récit — même si la légèreté est loin d'être absente — adopte une teinte plus mélancolique, trouvant sa pleine force émotionnelle dans un court épilogue, au cours duquel notre vieillard, fantasque, contemple, apaisé, tout ce que la vie peut offrir de sombre et de lumineux. On suit cette fois notre personnage principal, d'une bonne dizaine d'années plus âgé, qui décide de s'occuper d'une orpheline, petite-fille d'une femme dont il avait été amoureux — sans retour — durant sa lointaine jeunesse.
Pourquoi ces deux récits, aussi écartés dans le temps, aussi indépendants l'un de l'autre ? Sûrement pour souligner que ce sont les deux seules aventures intenses qu'il ait connues lors de son long age terrestre très casanier.
En tout cas, aussi bien grâce à sa forme qu'à son fond, j'ai éprouvé du plaisir à me replonger dans de l'Anatole , par le biais de ce roman de jeunesse lui ayant permis d'entrer dans la gloire — qui lui a été, à tort, retirée quelques années après son dernier souffle. Ce grand écrivain doit retrouver la lumière. De mon côté, à ma modeste échelle, je compte ne pas le laisser dans l'obscurité en continuant à découvrir son œuvre.