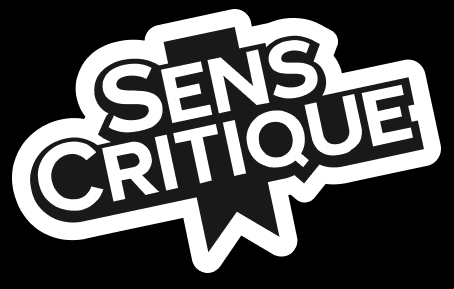Je ne sais pas ce qui a pris à Cédric Klapisch de confier le rôle-vitrine — si je puis m'exprimer ainsi — à Suzanne Lindon, le personnage qui est le cœur de l'histoire (et d'une !). Elle ne dégage rien. Elle n'a pas de charisme. Elle n'est pas cinégénique. Et la séquence dans laquelle Félix Nadar s'extasie devant elle et veut absolument la photographier m'a fait doucement rire pour toutes les raisons évoquées ci-dessus. En outre, elle ne ressemble pas du tout physiquement à Sara Giraudeau (et de deux !), censée interpréter sa mère.
Pour les autres jeunes comédiens, l'entourant dans la partie se déroulant à la fin du XIXe siècle, Paul Kircher (fils de — et de trois !), qui faisait beaucoup plus forte impression dans Le Règne animal... Il faut bien préciser que dans son cas, il avait eu droit, dans le film de Thomas Cailley, à un personnage nettement plus consistant — et Vassili Schneider (frère de — et de quatre !) sont d'une incroyable transparence.
Il n'est pas étonnant que j'aie trouvé la partie contemporaine supérieure.
Parce que dans cette dernière, sans faire des étincelles, il y a Vincent Macaigne, qui certes fait du Vincent Macaigne, Julia Piaton (et de cinq !) du Julia Piaton, Zinedine Soualem du Zinedine Soualem, mais quand ils apparaissent, on les voit, eux, au moins. Il y a aussi — assez fadasse en comparaison de ses trois partenaires — Abraham Wapler qui fait du... je n'en sais rien, je ne le connais pas... attendez... je vais regarder sa fiche Wikipédia... mais putain, c’est Népoland ce truc... D'accord, c'est une œuvre sur la famille, l'héritage, la transmission, mais à part l'arbre généalogique des Habsbourg d'Espagne, il n'y a pas plus consanguin que ce film... et de six...
Il y a aussi Raïka Hazanavicius (et de sept !), mais pour le coup, cette fois, le choix est pertinent, car elle est très photogénique (le contraire aurait été un comble, étant donné qu'elle incarne un modèle de mode !). Je regrette que son personnage disparaisse bien vite pour ne plus revenir (je vais y revenir plus bas !).
Niveau mise en scène, à part quelques fonds verts dégueulasses dans la partie XIXe, je n'ai rien à dire, sinon que, comme d'habitude, la réalisation de Cédric Klapisch est assez bien rythmée ainsi que soignée, les ages entre les époques étant notamment assez fluides.
Bon, alors, l’histoire est divisée en deux récits parallèles, mais liés l’un à l’autre, ayant recours au même procédé narratif que Le Parrain II — le clin d’œil, avec la tour Eiffel, à la séquence de la statue de la Liberté dans le chef-d’œuvre de Coppola, n’est pas difficile à remarquer — avec, comme je l’ai déjà mentionné, une partie à notre époque et une autre qui se déroule à la fin du XIXe siècle, quand elles ne se confondent pas toutes les deux lors d’un trip hallucinatoire.
Le tout est assez éiste, mais c’est assumé à fond, et je m’avoue coupable de la même chose. Ben ouais, comment vous ne pouvez pas kiffer une période lors de laquelle vous aviez la possibilité de croiser des génies comme Claude Monet ou Claude Debussy, entre nombreux autres. Bon, après, on ne va pas se mentir, le XIXe siècle est dépeint de la façon la plus idéaliste qui soit (la seule ombre qui aurait pu noircir le tableau, à savoir la maison close, est très rapidement mise de côté !).
Il y a plein de sous-intrigues qui sont négligées, comme le fait que la protagoniste apprend à lire et à écrire (ce qui aurait peut-être donné une bonne occasion d’offrir un peu plus de consistance à un des deux principaux personnages masculins de la partie XIXe ; l’absence de charisme serait toujours là, mais bon, faute de mieux… !), comme les rapports qu’elle entretient avec sa mère, comme les diverses romances, comme les existences personnelles et professionnelles des quatre protagonistes de notre époque (trop survolées pour le personnage de Soualem, quasi inexistantes pour ceux de Piaton et de Macaigne !). Wapler est un peu mieux loti pour ce qui est de la vie professionnelle de son perso, mais sa vie sentimentale aurait pu être plus creusée.
Ce qui aurait fourni un rôle nettement plus important à Raïka Hazanavicius, mais surtout à Claire Pommet (plus connue sous son nom de chanteuse : Pomme !), qui est pétillante, que la caméra adore, qui arrive à insuffler beaucoup de charme dans le trop peu qui lui est laissé. Pour tout avouer, je pense qu’il aurait été plus pertinent de la part de Klapisch et de son coscénariste habituel, Santiago Amigorena, de supprimer carrément son personnage (pour approfondir à la place les relations du couple formé par les jeunes gens à qui Wapler et Hazanavicius prêtent leurs traits !) et de lui confier le rôle principal. Là, le film aurait été porté par une actrice suffisamment charismatique pour être une tête d’affiche, et qui aurait rendu crédible le fait que Nadar s’extasie — sans parler du fait que, physiquement, il y a un plus grand air de ressemblance avec Sara Giraudeau.
Une autre très bonne surprise dans cette distribution est la présence lumineuse de Cécile de qui — oui, encore — dans le trop peu qui lui est laissé (la construction des personnages n’est clairement pas le point fort du film !), réussit à instaurer une ambiance chaleureuse, quand elle ne nous fait pas cadeau du seul moment d’humour efficace du film.
Bref, ce n’est pas que cette plongée dans un é familial, résolument humaniste et portée par l’impressionnisme, soit inintéressante — et Dieu sait que j’adore ce mouvement pictural et ses brillants représentants — j’ai même failli me ramasser un syndrome de Stendhal lors de ma première visite au musée d’Orsay... c’est pour vous dire... euh, comment ça, vous vous en foutez ? — enfin bref... le tout sur fond d’impressionnisme — ce qui contribue inévitablement à apporter une plus-value artistique pas du tout négligeable — mais entre la fadeur d’une partie de la distribution — ô népotisme, quand tu nous tiens — et un manque complet de profondeur dans la caractérisation des personnages, principaux ou secondaires (défaut que l’on peut relier aux multiples sous-intrigues négligées !), il est compliqué pour le spectateur de s’investir émotionnellement (pourtant, il y avait du potentiel !).