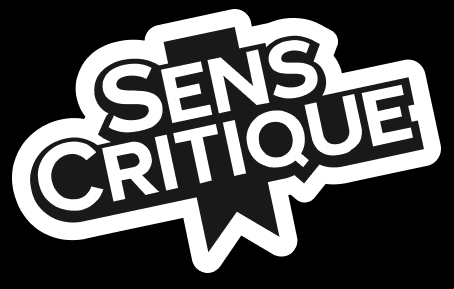Notre note est neutre et ne reflète rien. L'article comporte plusieurs spoilers.
Il y a une ion du sociologique chez Haneke : la volonté de dévoiler les formes de violence à l’œuvre dans nos rapports sociaux et, ce faisant, questionner radicalement nos manières de penser et d’appréhender la réalité. D’où l’adjectif « réflexif » que des critiques pressées accolent souvent à son cinéma – adjectif impropre, mais qui dit assez bien sa volonté, non pas de se regarder, mais de donner à voir. D’où son apparente froideur, qui relève davantage de la neutralité scientifique. Dans Code inconnu, les détracteurs d’Hanneke trouveront matière à polémiquer, car son anti-clacissime se radicalise encore dans une esthétique du fragment et un sabotage en règle du dispositif choral.
Éclatement
Le film raconte les vies entrecroisées de six protagonistes, mis en par un événement déclencheur : Jean (Alexandre Hamidi), un jeune homme qui tente de fuir son père, jette un emballage usagé sur une mendiante assise au coin d’une rue. Ce geste, c’est bien sûr celui d’une indifférence à l’autre que trahit l’éclatement de la société française, et dont Haneke va rendre compte dans l’éclatement de sa structure : constitués d’un seul plan, les séquences débutent et finissent in medias res, métaphores d’un morcellement structurel de nos existence. Plus rien ne relie les scènes que cet appareillage thématique : ni récit, ni transitions, ni raccords ; les plans, tout comme les individus, sont mis à distance les uns des autres. Mise à distance redoublée par l’écart géographique des personnages – Maria (Luminița Gheorghiu) en Roumanie, le père d’Amadou (Djibril Kouyaté) en Afrique, le reste en – ainsi que leur écart social – prolétaires et bourgeoisie culturelle se côtoient sans jamais se rencontrer.
Ce dispositif trouve son point d’orgue dans le portrait de Maria, immigrée roumaine, qui condense à elle-seule un éloignement au carré. Éloignement avec son pays d’immigration, puisque les autorités la refoulent à la frontière ; mais aussi éloignement avec son pays d’origine. La séquence de son retour en Roumanie, quand sa fille lui fait visiter la maison en chantier, fait la preuve d’un écart impossible à combler : le age du temps. Pour son voyage de retour vers Paris, Haneke prendra soin de la filmer dans la cale d’un bateau : lorsque la trappe se refermera, un noir total l’engloutira. Ce noir, c’est celui qui sépare toutes les séquences. Une manière de montrer que Maria n’a plus de pays et qu’elle habite désormais les interstices. L’angle mort dans lequel règne l’indifférence.
Incommunicabilité
En plaçant, dès la première scène, une jeune sourde-muette qui échoue à faire deviner le mot qu’elle mime à ses camarades, Haneke signale l’incommunicabilité comme point structurant de Code inconnu. De fait, le film ressemble parfois à une étude comparative de paroles manquées ; c’est-à-dire qui manquent leur cible, ou sont incomprises, ou sont empêchées : lors d’un rendez-vous galant, Adamou (Ona Lu Yenke) raconte une anecdote paternelle que les allées-venues d’un serveur ne cessent de différer. Un moyen d’inclure le collectif dans l’acte communicationnel et de rappeler, très concrètement, que la parole ne saurait s’excepter de sa situation d’énonciation. On parle toujours quelque part et ce quelque part nous empêche parfois de parler.
Par effet de miroir, le film restitue d’autant mieux l’émerveillement de la parole entendue – au sens de comprise – qu’il ne cesse de la montrer en défaut. Dans la séquence avec Amadou, ce dernier finit par dire à la jeune femme qu’il n’apprécie pas sa montre. Elle décide alors de la jeter dans le cendrier. Moment exceptionnel, où Amadou se montre désarçonné : par sa propre parole, dont il comprend la brutalité ; par l’écoute attentive de cette femme, qui l’a entendu et décide, dans un geste naïf, de se conformer à son désir.
Dans ce grand tableau dressé par le film, l’art occupe une voie de secours par laquelle il serait possible de s’écouter soi-même. Lors d’une séance de doublage, Anne doit dire « je t’aime » à un autre comédien. Un fou rire l’en empêche et l’ingénieur son finit par la tancer : « Tu as donc tellement de mal à lui dire je t’aime ? » Si Anne ne parvient pas doubler son personnage, c’est parce que la réplique de son personnage lui révèle ses sentiments naissants pour ce comédien. Le cinéma serait, dans cette optique, une communication tierce. Un moyen possible de nous révéler à nous-même. Difficile néanmoins d’être optimiste devant la conclusion du film : tous les personnages quittent le cadre sans avoir pu s’expliquer. En saturant la bande-son de percussions, Haneke évacue de toute façon toute communication verbale pour orienter le regard du spectateur sur le reste : l'inquiétude d’Anne, la détresse de George, la peur de Maria.
Difficile de dresser un panorama d'un film qui vaut pour chaque séquence, qu'il faudrait décortiquer avec précision, et qui ne se limitent pas à la thématique discutée plus haut. Haneke montre un savoir-faire inégalé quand il s'agit de condenser plusieurs sujets, ou émotions contradictoires dans une même séquence, et c'est chamboulé qu'on ressort de Code inconnu. Parfois, sans même savoir pourquoi.